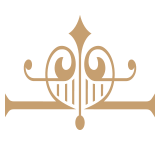En commençant cette série de textes, cherchant à remonter je ne sais quelle origine pour mieux comprendre ce que j’appelle « littérature » ou ce que j’en attends, j’avais une idée préconçue : je pensais que mon appétit de lecture avait originellement à voir avec la connaissance, le savoir. J’y plaquais ce que je nommerais pompeusement ma « trajectoire intellectuelle », que j’ai tendance à résumer à un cheminement de la foi en la toute-puissance de la raison à la confiance primordiale en l’intuition – simplification pas tout à fait abusive s’il s’agit de savoir à quel saint on se voue, mais sans que l’une ait en réalité jamais exclu l’autre. Je voulais pour preuve de ce cheminement l’époque où, enfant ou adolescente(au collège, me semble-t-il ; je ne devais pas être bien plus âgée, puisque je n’avais pas perçu que ce souhait n’entrait pas exactement dans la même catégorie que « devenir grande »), je rêvais de devenir proprement encyclopédiste : comprendre l’ensemble de l’Univers, le monde entier, avoir fait le tour de toutes les « sciences », tout savoir. Découvrir la signification de ce terme m’avait ouvert une vision du paradis.
Or voilà que, retraçant mon rapport aux livres, c’est tout autre chose qui me saute aux yeux. D’abord, une histoire affective plutôt banale : les livres ou les peluches, cela revient finalement au même pour l’adulte nostalgique, et le goût des uns plus que des autres dépend d’abord du milieu social, quoi qu’il devienne par la suite. Le vrai souvenir fondateur ne remonte en définitive pas si loin, c’est celui de ce commentaire sur Rousseau – jamais oublié, mais si évident finalement que l’expliquer me semblait inutile.
Je l’ai déjà évoqué comme une « révélation » rendant compte d’un émerveillement. Le terme n’est pas trop fort si l’on considère que, loin de ne décider que de mes études, il m’a bien plus largement la voie en instituant d’emblée les prémisses de ce que serait ma relation au monde – même si je ne le mesurais pas alors et bien qu’il m’ait fallu fort longtemps ensuite pour la constituer à peu près (ce qui est d’ailleurs toujours en cours).
Je crois que ce qui s’y est joué de si primordial pour moi relevait de la réconciliation entre la raison (l’exercice scolaire) et l’émotion (l’effet du texte sur la lectrice), jusqu’alors séparées selon une opposition très occidentale et puissamment relayée dans le discours familial. Autrement dit, cela m’offrait un aperçu de la définition que j’en suis venue à donner peu ou prou à la pensée : l’alliance consciente de la réflexion et de la sensation – ou de l’affect au sens le plus neutre possible –, ou encore cet aller-retour entre le monde et soi, l’intuition y servant de passerelle et de guide, qui s’entraîne sans doute à la faveur du reste, tel un substrat issu de l’expérience renouvelée.
Or, si je reprends le partage établi dans le premier texte entre lignes et couleur, qu’est-ce qui tient le rôle de l’intuition ? Il n’y a rien à voir si nulle couleur, nulle sensation, ne s’épanche, qui « vient vous chercher » ; mais verrait-on sans tracer de lignes – sans contours qui délimitent, raison qui ordonne ? La question n’est pas tout à fait rhétorique : si cette nécessité de la ligne ne fait guère de doute, s’en tenir là pour laisser à cette clarté le dernier mot n’est absolument pas satisfaisant, pour deux raisons. D’abord, la fleur n’a nul besoin d’être visible pour exister : la raison n’est qu’un temps dans un mouvement plus vaste. Ensuite, délimiter revient à analyser et choisir, il faut exclure tout un environnement ou toute une série de détails pour faire le point sur l’objet ainsi nettement cerné : encore une fois, s’en arrêter là démembre l’expérience vécue. Le péril de la raison est toujours l’abstraction – destinée à figer. Voir, penser, engage un mouvement, un dialogue infini, où alterne le consentement à se laisser éblouir et l’effort de rendre clair. « Éblouir sans aveugler » ne se pourrait alors que dans le temps – dans le langage, miraculeusement ou évidemment linéaire, s’il accepte de ne pas conclure autrement que la vie : sur l’inconnu.
Du moins est-ce un tel usage de la langue que j’appelle « littérature » – évacuant tout ce qui rapproche du roman à thèse aussi bien que du roman « feel good », Et c’est pourquoi elle est selon moi infiniment supérieure à toute autre discipline de la pensée. Refusant d’être définitive, elle entretient doublement ce dialogue avec le monde – celui de l’auteur avec ce dernier, mais aussi celui du lecteur avec l’un et l’autre. Elle rend alors pour moi compte de l’exacte nature du langage : lieu d’échanges vibratile, semblable à la peau, par lequel nous appartenons au monde et à son inconnu. Les mots n’ont pour moi rien d’abstrait. Je ne connais pas de vérités ; mais je connais son envers, qui n’est pas l’erreur ni la fausseté quand bien même ils en seraient un indice : les mots sonnant comme du fer-blanc.

Odilon Redon, La Chute d’Icare.