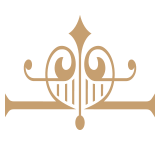À JMA.
Comme une récente conversation (épistolaire et… à bâtons rompus) avec un ami en était venue à évoquer la psychanalyse, je lui écrivais récemment qu’« occulté » me semblait un terme bien mal choisi, que rien n’était à proprement parler caché, dissimulé – sinon ce qu’autrui essaie de mettre sous le tapis, ajouterais-je ici. Au contraire, je comparais l’occulté à l’« éblouissant ; donc aveuglant », et rapprochais ce qui s’y joue d’une photo nette, et même très nette, mais qui serait au centre surexposée, empêchant de rien voir ; l’aveuglante lumière tirant en outre de l’ombre mille détails qu’aurait estompés un meilleur réglage et leur conférant quelque qualité d’hallucination – la photo que je « voyais » pourtant en imagination n’étant pourtant pas celle que je décrivais, mais une photo dont le centre aurait brûlé, laissant un trou irrégulier aux bords roussis. Après tout, il suffit d’une loupe pour que la lumière du soleil enflamme n’importe quel papier, fût-il glacé.
Dans cette lettre, le terme « éblouissant » est venu de lui-même. J’ai souri en retrouvant l’idée par laquelle j’ai entamé cette série de textes, à laquelle elle devait, quoique assez mollement, servir de fil directeur – pierre d’attente suffisante, en tout cas. Je ne me rappelais pas pour quelle formule j’avais opté dans le premier texte. Mon sourire a redoublé en trouvant : « éblouir sans éblouir ». Parfait, je tenais ma réponse – les paradoxes ne déçoivent jamais. Mais sont souvent un peu trop commodes.
Pourquoi diable ne voudrais-je pas éblouir ?
*
Je suis et je reste lectrice éblouie. J’ai beau avoir consciencieusement réuni savoirs et méthodes pour déverrouiller les textes, m’y ouvrir des portes et y pratiquer tel prélèvement, les soumettre à telle analyse aussitôt remise à l’épreuve, les juger et même en condamner bon nombre sans l’ombre d’une arrière-pensée ; je peux bien avoir assez consciemment cherché à me « déséblouir », ou du moins à m’assurer de ne pas l’être sans raison, c’est-à-dire de pouvoir comprendre ce qu’a d’admirable et d’unique l’écriture de tel ou tel auteur, et qui le démarque de pisse-copie plus ou moins intelligents et doués ; il n’en serait pas sorti grand-chose si ne subsistait, premier, à chaque fois redécouvert dans une inaltérable jouissance, cet éblouissement de plus en plus éblouissant à mesure que la lectrice s’enfonce dans le réseau des phrases, démonte la mécanique et s’attarde sur la pulsation du rythme. Aurais-je seulement poursuivi l’effort, autrement ? J’entre dans le texte comme dans un corps offert. Et si étincelants ou patinés que soient les outils de l’analyse, la dissection à laquelle il m’arrive encore de me livrer aurait finalement moins à voir avec la médecine légale qu’avec la nécrophilie, si elle ne ressemblait pas plus encore à la vivisection. Comparaison grotesque à dessein, car m’obsède depuis longtemps la crainte de tuer le texte par cet exercice, ou bien celle de substituer ma parole à la sienne. (C’est une des plus intimes raisons qui m’ont conduite à ne pas continuer dans la recherche universitaire. Ne pas faire d’un autre mon ventriloque. Et ne l’être pas davantage moi-même.)
Bref, mon idéal de lecture est éblouissement, à une exception près : quand je reconnais trop un de mes propres éblouissements, celui face à la photo surexposée-brûlée. Réaction excessive, en partie due à ce qui est ravivé. Mais aussi dû à une certaine méfiance et à une déception : un faux mystère, qui tire son effet du sujet davantage que de sa recréation, et ne tire son universalité que de sa banalité. Un peu comme un poème d’amour – et les deux se marient aisément, pour un maximum de poudre aux yeux.
Je suis bien sûr excessive, je pourrais énoncer bien des exceptions au second cas, bien que je sois moins aguerrie pour le premier. Mais si je taille à grands coups de machette, c’est pour m’ouvrir mon propre chemin. Alors laissons la lectrice à son éblouissement, et précisons l’autre versant : éblouir sans être éblouie ; sans m’éblouir. J’enfonce très probablement une porte ouverte, mais l’erreur était si grossière qu’elle m’amuse. Mon sempiternel rêve de fusion. Comme si j’étais à la fois tous les auteurs et tous les lecteurs. Un seul pronom vous manque et tout est défiguré. L’oubli de ce moi n’a ici rien de modeste…
Il n’est pourtant pas non plus aussi arrogant que l’on croit. En fait, ce tour de passe-passe rend très exactement compte de mon rapport fondateur à la littérature. Je m’y suis cherchée, constamment, et je m’y suis trouvée en y rencontrant l’autre. Ce qui revient à dire, me semble-t-il que n’importe quel lecteur qui se déprend un instant de l’immersion a de tous les phénomènes de projection en autrui (dans ces héros auxquels on « s’identifie » ; j’ai très tôt cherché l’auteur derrière eux, mais ce n’est que faire reculer d’un cran le mécanisme, ou plutôt repérer le second miroir – et l’on n’en finit plus) une idée parfaitement fine et précise. Un peu l’inverse de l’oubli du pronom me, mais assez fidèle à mon rêve de fusion.
J’ai bel et bien écrit en m’éblouissant. Voire en me laissant éblouir. Et cette fois, c’est moi l’autre que j’ai rencontré ; moi que j’ai trouvée – désolée d’énoncer si grandiloquente platitude. Il y aura tout de même fallu, outre ce trésor de lectures, une ribambelle de causes, dont un lecteur, un seul, qui n’avait rien d’un être de papier. L’autre rencontre, incarnée. Et les mots, comme chemin pour me ramener à moi à travers l’étrange double de l’aliénation (l’alius tellement plus lointain que cet alter qui peut devenir ego).
La muse, l’inspiration, le furor poétique sont sans doute de ce côté-là. Du côté où la parole est celle de la chair, bouillonnante, brouillonne, impérieuse et hantée. À divers titres possédée.
*
Alors très bien, éblouir sans m’éblouir.
Mais est-ce un programme, ou un regret ?
Un regret.
Aussi vaste que vain – quelque de chose qui s’est réalisé en écrivant, advenu, révolu
Et en réalité hors de propos – hormis d’ignorance.
Parce que je n’ai jamais souhaité éblouir en prenant la plume. J’ai voulu convaincre, en montrant. Mais je l’ai voulu intensément – ardemment. Il se trouve que ce que j’avais à montrer était cette photo et son point focal, surexposé, brûlé ; que ce que j’avais à montrer me montrait éblouie. Le fond et non la forme, si l’on veut (mais l’on ne veut pas, puisque le geste de l’écriture reviendrait justement à rendre inopérante une telle distinction) ; ou plus exactement le donné, non le choix.
Trêve d’éblouissement. La lumière suffit amplement. Mais il faut la choisir opiniâtrement, follement. Au sein de la nuit. Choisir la lueur de l’étoile morte.
 © Tatiana Plakhova, Chaos & Structure.
© Tatiana Plakhova, Chaos & Structure.