À qui n’est-il pas arrivé de rêver sur le simple titre d’un roman, sur l’esquisse tracée par une quatrième de couverture moins mauvaise que les autres ou sur les quelques mots par lesquels un ami, un libraire ou un enseignant en aura parlé ? Bien des piles à lire croulantes s’expliquent par cette simple promesse, sans cesse réitérée, sans cesse crue avec ferveur… et presque sans cesse déçue.
Ce n’est cependant pas tout à fait sur ce genre de promesse que j’ai acheté le dernier roman de Lucien Raphmaj, Une météorite nommée désir. Je connais un peu l’auteur, plutôt bien son univers qui entre en résonance avec mon imaginaire de façon étonnante, et, ce qui ne gâte rien, sa démarche d’écrivain est souvent aussi originale que diablement intelligente – un adjectif que l’on emploie trop peu pour les romanciers, peut-être parce que cette qualité est trop rare. De quoi s’emparer aveuglément de son dernier ouvrage et en attendre un peu plus que d’un autre, sans doute. Pourtant, le titre trop référencé et le pitch plus intrigant que poétique, reposant sur un SMS, ne m’enchantaient en fait pas particulièrement, et je n’y voyais guère la formule de quelque promesse que ce soit. Pire, un faux départ de deux pages à peine inaugurait la lecture par un échec. Il faut dire, pour être juste, que je me flatte d’avoir une bibliothèque assez variée pour répondre à la moindre de mes humeurs. Si je me suis résignée à reposer le livre à peine entamé, c’est que je sentais que le moment n’était pas le bon et qu’insister ne ferait que nuire au roman. Au demeurant, il est rare que les livres ne séjournent pas des mois, voire des années dans la pile à lire, seuls certains de mes auteurs chouchous bénéficient d’un traitement privilégié, alors il n’était pas bien grave de retarder le moment de la lecture.
J’ai repris Une météorite nommée désir un ou deux mois plus tard. Amusée, cette fois-ci, par le délire organisé et imparable du premier chapitre. Il offre de l’angoisse une vision inattendue, puisque c’est une partie de Snake (oui, ce jeu vidéo basique qui hantait naguère n’importe quel téléphone portable) qui en livre l’expérience, selon une définition bien particulière en l’associant à la nécessité d’être « à la démesure de l’univers, du désir et de l’impossible » – idéal « qui ne peut qu’échouer », d’où l’angoisse et même la panique (( Dont je ne crois pas tout à fait inutile de préciser qu’elle a à voir avec le dieu Pan, dont le nom signifie « tout ». Peut-être une des raisons pour lesquelles l’écriture de Lucien me parle tant tient à un goût partagé pour l’étymologie, que nous cultiverions à un point tel que recourir à ce réseau de sens qui irrigue les mots plus courants nous est presque instinctif. )) . Pages à la fois étonnantes et profondes, pleines de poésie, mais qui, je l’avoue, m’ont d’abord laissée dubitative malgré tout, tant l’acrobatie était visible – pas cabotine, mais, peut-être, forcée. Peut-être.
Je disais au début que le titre ne m’a pas fait rêver. Mais le roman lui-même m’a puissamment troublée, et il a rempli la promesse qu’un autre livre n’avait su tenir pour moi : la fleur bleue idéale de Novalis, dont le parfum ne m’est pas parvenu dans Henri d’Ofterdingen, je la trouve ici dans toute son éblouissante évanescence.
Ou peut-être pas. Car le roman se poursuit, progresse selon un déroulement très simple, purement linéaire, au gré de l’itinéraire de la narratrice. Cheminement qui va de pair avec celui des pensées, puisque les péripéties, si péripéties il y a, ne seront que mentales, fantasmées… écrites, pourrait-on dire. En d’autres termes, c’est bien dans un délire que nous sommes plongés d’emblée, qui vise moins à exhiber un tour de force qu’à rendre compte le plus fidèlement possible des élans et errements d’une pensée. « Ce doit être un vrai cinéma dans ta tête », remarque bien la collègue de notre narratrice, qui se montre d’abord hésitante sur ses talents de réalisatrice. Mais la métaphore fait tout de même mouche, et elle envisagera plus loin de « réaliser » un film – dans toute l’ambiguïté qu’implique ce terme.
« Peut-être que c’est ça, un film-rituel, un film pour quitter ce monde, ce vieux monde de l’enfance, un film pour accepter enfin de ne pas tout expliquer, de ne pas s’échapper en permanence en fictions toujours multipliées. Oui, faire ce film pour faire advenir ma réalité. La fixer une fois, moins moi-même, que l’univers. »
Telle est, qui sera porté à son paroxysme, l’enjeu du délire en quelque sorte conscient à laquelle la narratrice décide de s’abandonner : faire advenir quelque chose dans la réalité. La quête du désir ne peut en effet être qu’attente puisqu’il ne se décide pas mais est reçu, comme un SMS, subi, comme une catastrophe, nous laissant impuissants, « en proie à ». Au paradoxe de l’idéalisme, qui la conduit à « [s’]emballer, [s’]étouffer. Encore. Et encore », comme prise par un « élan de momification », la narratrice ne peut répondre qu’en se laissant guider par ce qui, du sein du mystère, fait signe. Entre force d’inertie et attraction magnétique, elle note ainsi :
« Saïph, Saïph, Saïph. Je me répète ce nom comme dans un film d’horreur, une invocation moderne, de celles qui ne marchent pas parce qu’on n’y croit pas. Pas vraiment. Qu’on n’y croit plus. Pas tout à fait. Qu’on y croit encore quelque part. Par où ? Par ailleurs. Parce qu’on y croit encore, et plus du tout, tout ensemble, comme ces vœux qu’on fait aux étoiles filantes. »
Et de fait, l’invocation « marche et ne marche pas tout ensemble », le délire suivi va métamorphoser. Les signes se révèlent ainsi plus simples à comprendre qu’on ne le croit dès lors que l’on se fie à l’intuition. C’est en suivant « les radiations du téléphone […] comme un sens caché à nos sens », un sixième sens, que la narratrice arrive à la boutique Rigel, où commencera à se dénouer l’intrigue.
Le délire à l’œuvre est ainsi moins fantasque que fantastique. Et même poétique si, se fiant à l’étymologie (ποιεῖν signifiant « faire »), on n’oppose plus actes et discours, mais que l’on fasse bien du délire une parole en acte – un « charme » dans toute la puissance du mot. L’espèce de contemplation à demi passive de la narratrice se retourne alors en participation au monde. Sa métamorphose, au terme de ce qui se sera révélé un parcours initiatique, est bien réelle. Or voici ce qui rend le roman de Lucien Raphmaj si troublant : cette initiation étant transcrite par le flux de pensée de la narratrice, qui poétise l’univers, le lecteur en fait partie, la vit avec elle. Pour peu qu’il ait sa Saïph, la lecture devient redoutablement intime, pour ne pas dire magique ou ensorcelante.
Je disais au début que le titre ne m’a pas fait rêver. Mais le roman lui-même m’a puissamment troublée, et il a rempli la promesse qu’un autre livre n’avait su tenir pour moi : la fleur bleue idéale de Novalis, dont le parfum ne m’est pas parvenu dans Henri d’Ofterdingen, je la trouve ici dans toute son éblouissante évanescence.
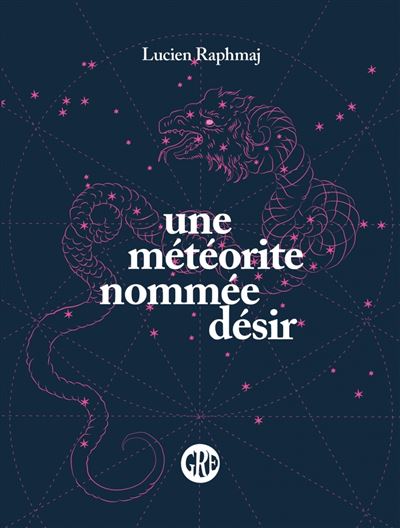
Lucien Raphmaj, Une météorite nomme désir
Éditions de l’Ogre
18€
ISBN : 978-2-37756-149-0
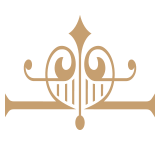
Suscite un désir hypnotique d’acquérir ces pages …