Roman et poésie ont toujours fonctionné chez moi selon deux régimes séparés. Le premier répondrait essentiellement à un idéal de construction et de mesures, éventuellement écorné en quelques pages, dans l’un ou l’autre passage entre deux « masses », mais qui demeurerait néanmoins le point de vue d’ensemble à adopter pour évaluer l’œuvre lue ou à faire. Bref, il est du côté du travail, de la raison, de l’architecture, et j’entends bien par « mesures » tout un effort de mise en harmonie par divers calculs, variables à l’infini en fonction du projet romanesque (longueurs de chapitres, fréquence de dialogues, de monologues…, répartition de personnages, poids et utilité de chacun, etc.). Évidemment, je ne prétends pas avoir jamais réussi, la plume à la main, à atteindre cet idéal (mais comme lectrice, je suis assez habile à le reconnaître et à juger en fonction de lui). Je suis plutôt d’y échouer avec labeur et opiniâtreté.
Le second régime, celui de la poésie, ne répond à aucun idéal. Je n’ai strictement aucune intention lorsque j’écris le premier jet d’un poème – ni même me semble-t-il quand j’en lis un, qui me saisit, que je comprends d’emblée ou non. Cette forme d’écriture est infiniment plus reposante, vous vous en doutez, quoique je n’avoue pas sans une certaine honte adhérer ainsi, dans les faits, au mythe du furor poétique, cette folie ou inspiration qui s’empare de vous sans que vous sembliez avoir rien à y voir, et qui paraît tout de même un peu courte pour expliquer ce qui se joue dans l’écriture. Ni effort ni volonté, juste un surgissement. Mais je vous rassure : j’ai toujours été une élève sérieuse (et même longtemps une cartésienne odieusement rationaliste), alors mes poèmes, normalement, je les reprends avant de les mettre en ligne sur le blog (pas sur Twitter, qui obéit au régime de l’instant). C’est à ce moment-là qu’intervient un travail plus « conscient », dirai-je – de même qu’il est effectué lorsque je m’attache à commenter un poème lu parce qu’il m’a « parlé », expression que je déteste entre toutes mais dont je suis bien obligée de reconnaître qu’elle exprime assez exactement ce dont il est question. Et, si effort et volonté entrent alors bien en scène, c’est avec une espèce d’assurance, de certitude d’arriver à bon port que je suis bien loin de rencontrer lorsque je me mêle d’écrire un roman (mais non de le commenter, là encore).
Aurais-je déjà pu écrire tout cela il y a un mois ? La différence entre roman et poésie que je sens me fascine depuis toujours, sans que je sois jamais arrivée à véritablement la saisir. Il m’aurait sans doute fallu des pages et des pages d’une élaboration logique et méandreuse, en deux mots peu évidente, pour arriver à cette ligne de crête départageant roman et poésie qui m’a si simplement sauté aux yeux ces temps-ci : c’est à l’image que je me fie. Plus exactement : à l’intuition qu’éveille en moi l’image. D’où mon inconfort (quoiqu’il se dissipe un peu désormais, mais j’y reviendrai) ou ma maladresse dès que j’écris un roman, que je fais reposer primitivement sur l’entendement ; alors que la poésie relèverait presque exclusivement de l’image et de l’intuition – c’est-à-dire, je crois, de la perception d’une unité non encore analysée, comprise –, et de mon fonctionnement finalement le plus spontané.
Comprenez-moi bien : je ne prétends pas que cette partition vaille pour quiconque à part, et je goûte trop la poésie didactique et le roman poétique pour seulement songer à la généraliser. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur l’opposition que je rends si frontale entre entendement et perception, raison et intuition – l’un et l’autre agissent évidemment de concert. Que la perception soit première, voilà sur quoi on s’accordera sans mal. Mais que ce soit à elle encore qu’il faille revenir pour guider et informer l’entendement à l’œuvre, cela est peut-être moins généralement admis. Pourtant, lorsque je dis que je me fie à l’intuition, c’est bien ce que cela recouvre : je me reporte à ma première impression, unique et unie, qui va au-delà d’une perception-enregistrement, dont n’importe quel outil serait aussi bien sinon mieux que moi capable, pour se faire perception-effet, me touchant, m’éprouvant intimement – ce que j’appelle donc l’intuition.
En somme, l’entendement ne m’est qu’un outil pour essayer de comprendre le trajet entre la perception et l’intuition et, partant, l’un et l’autre. Rôle d’intermédiaire entre ce qui est et moi, mais rôle subalterne, donc.
Je ne sais pas dans quelle mesure tout cela paraîtra banal ou peu intéressant à mon lecteur. Mais pour moi, qui ai reçu une éducation et une formation d’abord scientifiques – que je ne renie pas, au contraire, et qui m’ont très certainement été on ne peut plus précieuses dans mes études de lettres –, puis à cause de divers déboires personnels, apprendre à me fier ainsi à mon « intuition », la reconquérir, aura été un long parcours dont il est assez merveilleux de récolter aujourd’hui les fruits.
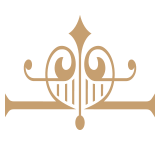
« l’entendement ne m’est qu’un outil pour essayer de comprendre le trajet entre la perception et l’intuition et, partant, l’un et l’autre. »
Agréable et rassurant de voir que l’on est pas seul dans ses rapports avec la raison (?)